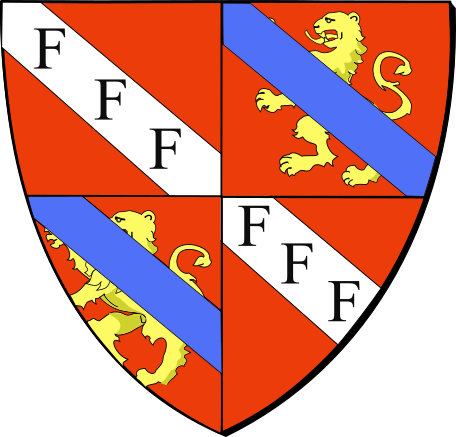La famille de Félix appartient à la grande noblesse de robe et
d’épée de Provence. Elle s’est illustrée particulièrement à la
nomination d’un de ses membres, le comte du Muy, premier
ministre de la Guerre de Louis XVI (1774) et maréchal de France
(1775).
Originaire d’Avignon, elle s’enrichit au début du XVIe siècle
dans le négoce, en particulier de la soie, qui était
manufacturée à Avignon et importée du Levant, et forme plusieurs
branches à Avignon, Aix et Marseille. Sa filiation au XVe siècle
reste toutefois incertaine.
Présentée dans les généalogies du XVIIIe siècle comme issue des
anciens Félici de Turin et des Grimaldi, cette version a été
réfutée à raison par la Critique de Barcillon,
reprise par Lainé (1818) et du Roure (1923), qui évoquent plutôt
une origine judaïque. Mais cette dernière hypothèse semble elle
aussi fragile, car fondée sur aucun acte et en contradiction
avec un réseau matrimonial des Félix d’Avignon, où l’on ne
trouve aucun néophyte mais bien des négociants italiens
(Peruzzi, Francia, Gagnon, Magis), et des prénoms de l’Antiquité
inspirés du quattrocento. Quoi qu’il en soit, les Félix ont « produit
assez de personnages illustres pour pouvoir se passer
d'ancêtres imaginaires », rappelait Chaix d’Est-Ange. Les
charges et services innombrables qu’ils ont rendus à la Provence
ou au royaume, le démontrent suffisamment.
Parmi les charges exercées, citons celles de : conseiller à la
cour des Comptes de Provence (1604), conseiller au parlement de
Provence (1699), lieutenant des soumissions à Aix (1603, 1638,
1666), conseiller au siège de Marseille (1627), trésorier de
France (1619, 1650, 1687), trésorier de la marine (1577),
contrôleur général de la marine (1573, 1614), consul d’Aix
(1679, 1754), consul de Marseille, gentilhomme ordinaire de la
maison du roi, médecin du roi.
Sur le plan militaire, celles de : lieutenant général des armées
du roi (1748, 1792), maréchal de camp (1744, 1745, 1788), chef
d’escadre (1671), commandant en chef de Provence (1734),
commandant en chef et gouverneur de Flandre (1762), major de
Marseille (1650), capitaine de galère, gouverneur de places
fortes, maréchal de France (1775). En outre, dix membres de la
famille de Félix furent chevaliers de Malte, dont un grand
prieur de Saint-Gilles (1719).
Appelés à Versailles sous la Régence, ils obtinrent auprès de la
famille royale les fonctions éminentes de sous-gouverneur et
sous-gouvernante (1728, 1735), menin (1745), maître d’hôtel, et
au cœur du pouvoir royal les charges de conseiller d’Etat,
directeur des économats (1733), directeur de l’hôtel des
Invalides, et ministre et secrétaire d’Etat à la Guerre (1774).
Les Félix ont porté les titres réguliers de marquis du Muy
(1697), comte de la Reynarde (1724), comte de Grignan (1732),
baron de Dauphin et Saint-Maime (1754), marquis d’Ollières
(v.1756), seigneur de la Ferratière (1532), seigneur de la
Jaconnière-Puget (1663), baron d’Empire (1811), comte et pair de
France (1817), et plus brièvement ceux de marquis de Saint-Phal
(1744) et comte de Ribiers (1751). Ils se qualifiaient également
seigneur ou comte de Villarfouchard en Piémont, mais ce titre
reste incertain car faisant partie, avec la Jaconnière (terre
savoyarde dont ils transportèrent le nom à un petit domaine à
Signes) des possessions devant accréditer leur origine
piémontaise. Maintenus nobles en 1668, au vu de titres falsifiés
pour toute la filiation précédant l’alliance Péruzzi de 1493,
ils ont été admis aux honneurs de la cour en 1785, et
s’éteignent en 1903.
Quatre figures se détachent particulièrement de cette famille.
Celle de Jean-Baptiste de Félix de la Reynarde (1678-1759) dit
le Comte du Muy (bien que marquis à la mort de son
père), conseiller au parlement d’Aix (1699), ami du cardinal de
Fleury qui l’attire à Versailles (v. 1715-1720), et lui procure
la charge de directeur des économats (1733) après avoir obtenu
pour son épouse la place de troisième sous-gouvernante des
enfants de France (1729). Ayant la confiance du roi, le Comte du
Muy est nommé dans la foulée commandant en chef en Provence
(1734), sous-gouverneur du Dauphin (1735), conseiller d’Etat
(1740), maître d’hôtel de la Dauphine (1744). Grand seigneur
provençal, il fait restaurer le château du Muy, bâtit une
bastide près d’Aix et agrandit son domaine de la Reynarde à
Marseille, il acquiert également le magnifique château de
Grignan avec son comté (1732). Il eut de son mariage avec
Marie-Thérèse de Mison, deux fils, qui grandiront près de la
cour et à Paris.
Tancrède de Félix, marquis du Muy (1707-1777), l’aîné,
lieutenant général (1748), prit part aux batailles de son temps
puis entra dans l’intendance de la comtesse de Provence (1771) ;
il maria sa fille unique, Marie-Anne, avec le dernier marquis de
Créquy, alliance qui ne sera pas heureuse, marquée par la mort
en bas-âge de leur unique enfant. Ruinée à la Révolution, Mme de
Créquy épousera en 1802 le capitaine de Bosroger ; son mince
héritage reviendra pour partie à ses cousins Forbin la Barben.
Louis de Félix, comte du Muy (1711-1775), le cadet, après avoir
mené une brillante carrière lui aussi, maréchal de camp (1745),
est nommé menin du Dauphin (père de Louis XVI), prince qu’il
connaît depuis son enfance et dont il sera l’ami le plus fidèle
jusqu’à sa mort. Gouverneur de Flandre (1762), chevalier des
ordres du roi (1764), honneur que sa générosité avait repoussé
d’abord en faveur de son frère aîné, il accepte en 1774 la
charge de ministre de la Guerre, après l’avoir refusée dix ans
plus tôt à Louis XV. Il reçoit le bâton de maréchal l’année
suivante, mais meurt tragiquement d’une opération de la vessie.
Caractère droit et inflexible, homme de devoir, « sincère
dans les cours, austère dans les camps, stoïque sans humeur,
généreux sans faiblesse, le mérite à ses yeux fut la seule
noblesse » (épitaphe de Sacy), il fut une figure noble et
parfaitement honnête de son siècle.
L’héritage des Félix du Muy passe ensuite, dans des
circonstances complexes, à leur cousin éloigné Jean-Baptiste de
Félix d’Ollières (1751-1820), colonel d’infanterie (1775),
combattant de Yorktown, maréchal de camp (1788). Adepte des
idées nouvelles, ce nouveau Comte du Muy sert dans l’armée
républicaine comme général divisionnaire, fait l’expédition
d’Egypte et termine sa carrière avec la croix de commandeur de
Saint-Louis, le titre de baron d’Empire puis celui de comte-pair
héréditaire (1817). Il avait épousé en 1788 Louise de Vintimille
du Luc, petite-fille de Louis XV, dont il n’eut pas d’enfant. De
fait, comme il en avait bénéficié lui-même, il laissa son riche
héritage à la branche aixoise des Félix, la dernière alors
existante. Celle-ci s’éteindra à la mort de Ferdinand de Félix
du Muy (1841-1903), propriétaire et ancien maire d’Ollières,
dont les sœurs sont entrées par mariage dans les familles de la
Fresnaye et de Coustin.
*
Armes : écartelé, aux 1 et 4 de gueules à la bande
d'argent, chargée de trois F de sable, aux 2 et 3 de gueules
au lion d'or à la bande d'azur brochante sur le tout.
Elles furent ainsi enregistrées à l’Armorial général par
Jean-Baptiste de Félix la Reynarde seigneur du Muy, Balthasar de
Félix, écuyer, Michel de Félix écuyer, lieutenant général aux
soumissions d’Aix, Philippe Joseph de Félix d’Ollières enseigne
de galère, et Jean-Baptiste de Félix la Reynarde.
Les armes des Félix sont les premières, les trois lettres F
rappelant leur devise : Felices fuerunt fideles, dont
la tradition attribuait l’origine à un comte de Savoie en 1247.
Les armes écartelées sont celles des Fraxinelli, de Verceil en
Lombardie.
Deux chevaliers de Malte, Joseph de Félix la Reynarde,
commandeur d’Espalion et ancien capitaine de galère, et Scipion
de Félix la Reynarde, y ajoutèrent naturellement en chef la croix
de Malte.
Paul de Félix de Greffet de la Ferratière chevalier, trésorier
général de France, inscrit lui aussi à l’Armorial, écartela : au
1, de gueules à la bande d’argent chargée de trois F de
sable (Félix), au 2 et 3, d’azur semé de billettes
d’argent au lion d’or brochant (Greffet), au 4 de
gueules au lion d’or à la bande d’azur brochant sur le tout (Fraxinelli).
A noter que les Félix de Creisset, de Mézel et Riez, adoptèrent
des armes identiques, bien que leur origine soit – en l’état de
nos connaissances – bien distincte : de gueules au lion
d’or à la bande d’azur brochant sur le tout. Ainsi
déposées à l’Armorial général par Honoré de Félix, seigneur de
Creisset, et par Joseph de Félix, bourgeois de Riez.